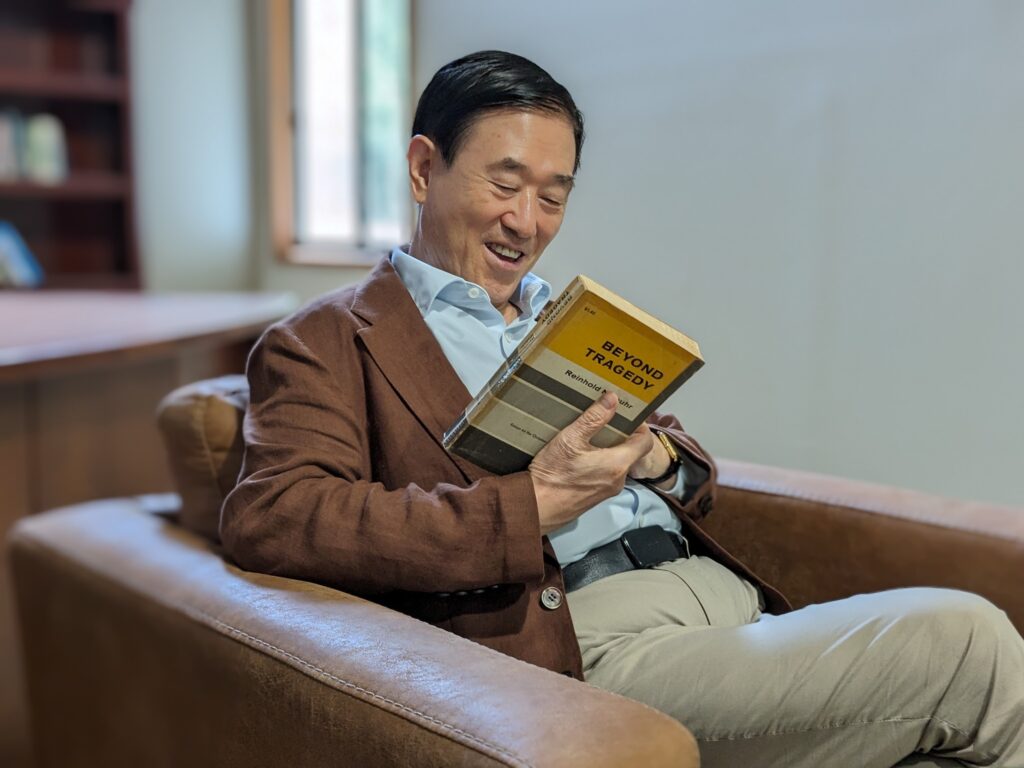
Le pasteur David Jang occupe une place singulière dans le paysage chrétien contemporain, tant par l’empreinte de son ministère que par ses positions théologiques. S’appuyant sur une étude et une méditation approfondies des Écritures, il met en avant l’importance de la vie chrétienne et de la mission de l’Église. Dans ses écrits et ses prédications, il souligne que l’Évangile de Jésus-Christ ne se limite pas à la transformation spirituelle de l’individu, mais exerce une influence beaucoup plus large sur la communauté ecclésiale et sur l’ensemble de la société. À ce titre, il est pertinent d’examiner ses réflexions sur l’essence du christianisme, sur l’orientation de la vie du croyant et sur la direction que devrait prendre l’Église, en se basant principalement sur le récit de l’arrestation de Jésus au Jardin de Gethsémané dans Jean 18,1-11. Selon David Jang, ce récit n’est pas qu’un simple témoignage historique, mais un texte qui nous invite à comprendre la “dimension d’engagement actif de l’Évangile” et qui offre une perspective sur la manière dont l’Église et le croyant doivent se confronter au mal et aux difficultés structurelles du péché dans le monde. Dans Jean 18,1-11, alors que Jésus se dirige vers la croix et que ses disciples se tiennent à ses côtés, nous entrevoyons des indications essentielles sur l’attitude à adopter face aux épreuves du monde et à l’emprise du péché. Pour le pasteur David Jang, ce passage illustre la tension et la décision spirituelles auxquelles toute Église et tout croyant sont inévitablement confrontés lorsqu’ils s’engagent à suivre Jésus jusqu’à la croix.
L’un des points centraux qu’il met en avant est la décision consciente et volontaire de Jésus-Christ d’emprunter la voie de la croix. Dans Jean 18,1-11, même s’Il connaît déjà la situation à venir, Jésus traverse le torrent du Cédron et se rend au Jardin de Gethsémané. La réaction humaine naturelle face à la mort ou au danger serait de s’enfuir, mais Jésus, au contraire, s’avance avec assurance devant ceux qui viennent l’arrêter. Sa déclaration « C’est moi » montre qu’Il est pleinement conscient de son identité et de sa mission. L’évangéliste Jean souligne ainsi que Jésus ne s’est pas fait “arrêter” passivement, mais qu’Il s’est plutôt “livré” de Lui-même. Pour David Jang, la confiance absolue et l’obéissance à Dieu qui ressortent de cette scène constituent le fondement de la foi que l’Église et les croyants d’aujourd’hui ne peuvent négliger. Parfois, dans notre propre vie, garder la foi exige d’affronter frontalement l’adversité au lieu de la fuir. David Jang répète souvent que « ce n’est pas l’évitement, mais plutôt l’acceptation active, à l’exemple de Jésus, qui fortifie et affermit la foi ». Il souligne régulièrement le paradoxe de l’Évangile dans ses prédications à propos de Jean 18. Jésus a enduré l’opprobre de la croix avec joie (Hé 12,2), un chemin quasi impossible à emprunter pour l’être humain, mais qui devient le lieu de la puissance divine.
David Jang développe davantage la portée spirituelle et théologique de cette décision et de cette obéissance de Jésus. D’abord, il perçoit la croix comme « l’endroit où la mort est vaincue par la mort même ». L’humanité, incapable de surmonter seule son péché et la conséquence qu’est la mort, voit Dieu venir en la personne de Jésus-Christ, « partageant chair et sang » (Hé 2,14), pour anéantir la puissance de la mort par Sa propre mort. Lorsqu’au Jardin de Gethsémané, Jésus dit : « La coupe que le Père m’a donnée, ne la boirais-je pas ? », Il révèle que ce grand plan de salut est intentionnel. Autrement dit, Jésus n’est pas victime d’un complot politico-religieux, mais Il se soumet à la volonté de Dieu afin de libérer l’humanité du péché et de la mort. David Jang insiste sur la beauté paradoxale de ce salut : la croix, qui peut sembler une défaite aux yeux du monde, constitue en réalité un chemin vers la victoire. Il appelle cela « la logique paradoxale du Royaume de Dieu » : extérieurement, on voit un sacrifice apparemment impuissant, mais, en vérité, c’est là que s’accomplit la victoire spirituelle. Ainsi, l’arrestation et la crucifixion de Jésus deviennent le point d’inflexion décisif de l’histoire du salut.
Dans la même perspective, David Jang distingue le « courage purement humain » de Pierre du « courage animé par la foi » de Jésus. Au verset 10 de Jean 18, Pierre, dans un élan de zèle, tire son épée et tranche l’oreille du serviteur du grand-prêtre, Malchus. On peut y voir un acte audacieux et juste, désireux de défendre le Maître. Cependant, Jésus lui ordonne de « remettre l’épée au fourreau » et proclame qu’il faut boire la coupe donnée par le Père. Pour David Jang, cet épisode montre que la foi chrétienne n’est pas seulement affaire d’“actions justes” ou d’“indignation morale”, mais consiste à choisir la voie de la croix voulue par Dieu. Bien que certains puissent user de la force pour établir la justice, Jésus ne l’a pas fait. Au lieu de cela, Il a rompu à la racine le pouvoir du péché et de la mort en devenant Lui-même victime expiatoire pour les pécheurs. David Jang souligne que « brandir des armes ne résout pas le problème fondamental du péché et de la mort ». La victoire spirituelle étant accomplie à la croix, où l’amour et la justice de Dieu se rencontrent, David Jang estime qu’une simple application de la justice humaine ne constitue pas la solution ultime de l’Évangile.
Selon lui, il convient de transposer ce message dans la manière dont l’Église et les croyants œuvrent dans la société actuelle. Face au mal et à l’injustice, le simple recours à “l’indignation morale” peut aboutir à de nouvelles formes de violence ou de division. Il insiste donc sur une « mise en pratique de l’Évangile dans la vie ». À l’exemple de Jésus, qui s’est livré Lui-même pour les pécheurs, l’Église devrait imiter la voie divine consistant à « renverser le mal à la racine par l’amour sacrificiel ». Concrètement, l’Église doit chercher à faire émerger un ordre nouveau par l’amour de la croix, plutôt que de vouloir s’imposer par la force ou la contrainte. L’attitude résolue de Jésus, qui se présente en disant « C’est moi », devient dès lors le modèle fondateur pour l’Église, appelée à être « la lumière et le sel » dans la société. Pour David Jang, si l’Église accepte de sacrifier ses propres intérêts et si chaque croyant fait preuve de l’amour de Christ dans sa vie quotidienne, alors elle recevra la force de s’attaquer même aux injustices structurelles du monde.
David Jang voit par ailleurs trois grands enseignements pratiques à tirer de la scène de l’arrestation au Jardin de Gethsémané. Premièrement, les “lampes” et “torches” qui auraient dû aider à porter la lumière de la vérité sont ici utilisées pour trouver et mettre à mort Jésus, ce qui met en garde contre la dérive légaliste et formaliste des institutions religieuses. Ceux qui auraient dû adorer Dieu et proclamer l’Évangile – les grands prêtres et les pharisiens – l’ont en réalité rejeté, mus par des intérêts politiques et mondains. Il y a un risque que l’Église d’aujourd’hui tombe dans le même piège. Deuxièmement, la proclamation « C’est moi » de Jésus témoigne de l’autorité et de la majesté divines, lesquelles demeurent inébranlables face à la puissance de la mort. Cela symbolise l’audace de l’Église quand elle demeure ferme dans la vérité, malgré la persécution et la peur qu’elle peut rencontrer. Troisièmement, la réprimande faite à Pierre (« Remets ton épée au fourreau ») enseigne à l’Église la posture fondamentale à adopter dans son rapport au monde. Il ne s’agit pas de vaincre l’injustice par la violence ou par la ferveur humaine, mais de transformer le monde grâce à l’amour, la grâce et l’esprit de sacrifice donnés par Dieu. David Jang relève que ces trois éléments se manifestent à maintes reprises dans l’histoire de l’Église, et que les croyants coréens d’aujourd’hui doivent en tirer les mêmes leçons.
De plus, imitant l’attitude de Jésus à Gethsémané, David Jang encourage chaque croyant à s’engager librement sur la voie de la croix. À ses yeux, connaître vraiment l’Évangile va bien au-delà de l’acquisition d’un savoir théologique ou de la familiarité avec des traditions ecclésiales. C’est une puissance de transformation de la vie, et cette vie transfigurée doit à son tour influencer positivement autrui. Comme Jésus s’est livré Lui-même pour protéger ses disciples, l’Église doit d’abord prendre soin de ses membres les plus vulnérables, et faire preuve de sacrifice pour favoriser leur rétablissement. Dans la même lignée, elle doit s’engager auprès de ceux qui souffrent dans la société, afin de leur rendre leur dignité humaine. David Jang cite volontiers Galates 6,2 : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Pour lui, ce commandement fait écho à l’attitude de Jésus arrêté à Gethsémané : Il n’a pas simplement défendu ses disciples, Il a également porté le fardeau du péché de toute l’humanité. De là découle, selon Jang, l’idée que porter les fardeaux les uns des autres commence par de petites actions concrètes, par le partage du fardeau et de la souffrance d’autrui.
Lorsqu’il s’agit de concrétiser ce message dans la vie ecclésiale, David Jang propose plusieurs orientations. Dans l’action sociale ou la mission, l’Église ne doit pas adopter une posture de condescendance, mais s’identifier aux personnes concernées, partager leurs difficultés et réellement répondre à leurs besoins, dans un esprit de “communion et de marche commune”. De la même façon que Jésus se retrouvait souvent à Gethsémané avec ses disciples (Jn 18,2), l’Église, en tant que communauté unie, est appelée à vivre la communion, à prendre soin des uns et des autres. Jang insiste sur le fait que Gethsémané est à la fois le lieu où Jésus se soumet complètement à la volonté du Père dans la prière, et celui où Il partage une intimité profonde avec les disciples. Il en conclut que l’expérience de la présence de Dieu et l’obéissance à Sa volonté ne doivent pas se vivre uniquement sur le plan personnel, mais aussi au niveau communautaire. Selon lui, la prière, le partage de la Parole et le service mutuel sont indispensables pour que “Gethsémané” devienne partie intégrante de notre quotidien.
David Jang ajoute que, si l’Église parvient à renouer avec la spiritualité de Gethsémané, les croyants acquerront ce qu’il nomme une « force spirituelle » pour affronter la voie de la croix. Pierre, dans un grand élan de zèle, prend son épée, mais finira par renier Jésus trois fois (Jn 18,15s). C’est, selon Jang, l’illustration de la facilité avec laquelle le simple enthousiasme humain peut se retourner en désarroi et en trahison. Seule la foi enracinée dans l’Écriture et fortifiée par la prière permet de tenir ferme au milieu de l’épreuve. D’où la nécessité pour l’Église d’exhorter régulièrement les croyants à consolider leur vie intérieure par la Parole et la prière, avant de stimuler le passage à l’action. Tandis que Pierre réagit par instinct en tirant son épée, Christ, Lui, maintient le cap sur la coupe que le Père veut Lui faire boire. Ce contraste montre l’ampleur du décalage entre « l’enthousiasme humain » et « la vie soumise à la volonté de Dieu ». À ce sujet, Jang considère essentiel que l’Église fournisse aux croyants un accompagnement spirituel, afin d’éviter qu’ils ne reproduisent l’échec de Pierre.
Pour autant, il ne déprécie pas l’action concrète des croyants, ni ne soutient l’idée d’une Église indifférente aux problèmes du monde. Au contraire, il enseigne inlassablement l’importance de la mise en pratique de l’Évangile. Mais il souligne que cette mise en pratique doit jaillir du cœur même du Christ, de ses motivations profondes, et être guidée par l’Esprit. Dans Jean 18, on voit que les torches et les lanternes, à l’origine des symboles destinés à éclairer la vérité, servent ironiquement à arrêter Jésus, la Vérité incarnée. De la même manière, l’histoire nous montre que l’Église a parfois usé d’actions violentes – pensons aux Croisades – en se réclamant de l’Évangile, mais en en trahissant l’essence. D’où l’exhortation de David Jang à se demander sans cesse : « Est-ce vraiment la voie de Jésus ? Notre définition de la justice et du changement est-elle réellement évangélique ? » Il invite à tirer les leçons de ces dérives historiques pour comprendre qu’il ne faut pas prendre l’Évangile comme un prétexte à l’usage de la violence, mais le vivre à la manière du Christ qui ordonne à Pierre de « remettre l’épée au fourreau », annonçant ainsi le salut par l’amour sacrificiel.
D’après lui, tout ceci implique également de s’abandonner à la direction du Saint-Esprit plutôt que de s’appuyer sur son propre vouloir. Pour David Jang, l’attitude de Jésus dans Jean 18 est le modèle d’un abandon total à la volonté divine : le Christ choisit la voie de la croix, appuyé sur la puissance du Saint-Esprit reçue dans la prière à Gethsémané. Même si la prière de Jésus à Gethsémané, où « sa sueur devenait comme des grumeaux de sang » (Lc 22,44), n’est pas mentionnée dans le détail dans Jean 18, Jang rappelle constamment que ce moment d’intense supplication, tel que décrit dans les Évangiles synoptiques, est au fondement de la décision de Jésus. De la même manière, aujourd’hui encore, toute action de l’Église doit être précédée d’une quête fervente de la sagesse et de la force de l’Esprit. Concrètement, même dans le service ou l’entraide, il ne faut pas s’attacher à l’aspect visible et grandiose, mais veiller à adopter le regard et le cœur de Jésus envers ceux qu’on sert.
Revenant sur la figure de Judas, Jang souligne que ce dernier, bien qu’ayant reçu un amour et un enseignement extraordinaires de la part de Jésus, est celui qui Le livre pour trente pièces d’argent. Jean 18,2 précise : « Or Judas, qui Le livrait, connaissait aussi ce lieu, parce que Jésus y était souvent allé avec ses disciples ». Ainsi, Judas est resté auprès du Maître, bénéficiant de Son enseignement et de Ses miracles, mais Il L’a néanmoins trahi. Selon Jang, l’exemple de Judas rappelle que recevoir la grâce de l’Évangile ne garantit pas automatiquement une bonne conduite. Même au sein de la communauté croyante, si l’on n’examine pas l’état de son cœur, on peut s’écarter à tout moment. C’est pourquoi il ne faut pas se contenter d’une croissance numérique ou de divers programmes d’animation ; l’Église doit aussi faire preuve d’une vraie sollicitude pastorale, en veillant sur la vie spirituelle de chacun. Puisque même quelqu’un qui était très proche de Jésus a pu Le trahir, il est du devoir de l’Église de veiller au bien-être intérieur de ses membres, de les accompagner, de prier avec eux et de maintenir un dialogue permanent.
Dans cette optique, David Jang prône la restauration de l’image de l’« Église-famille spirituelle ». Une famille où l’on connaît les forces et les faiblesses de chacun, où l’on peut se blesser mutuellement, mais où l’on assume néanmoins l’engagement et la responsabilité partagés, afin de grandir ensemble. Pour lui, l’Église ne doit pas rester un « rassemblement anonyme » où l’on assiste au culte avant de repartir, mais être un lieu de soutien réciproque dans la prière, le service, et dans l’accompagnement des âmes. Se référant à l’injonction de Jésus : « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation » (Mt 26,41), restée lettre morte puisque les disciples se sont endormis, il demande : « Sommes-nous vraiment une Église qui veille et qui prie ? » Il rappelle qu’on ne peut se contenter d’enchaîner les manifestations et les offices : c’est en priant et en portant le fardeau les uns des autres, dans la compassion pour les besoins d’autrui, qu’on provoque un réveil spirituel authentique.
David Jang relie également le « geste souverain » de Jésus dans la scène de l’arrestation à la question du leadership ecclésial. Bien qu’Il ait pu s’y soustraire, Jésus se livre volontairement en disant : « C’est moi ». Ainsi, le vrai leadership ne cherche pas avant tout à se protéger, mais à servir l’intérêt du groupe, acceptant la possibilité du sacrifice. Quand l’Église collabore avec les puissances du monde pour assurer sa stabilité ou recourt à une autorité répressive en interne, elle s’éloigne du modèle de Christ. Jang souligne que l’Évangile établit son autorité par l’amour concret et le sacrifice de soi. Il exhorte donc particulièrement ceux qui exercent un ministère ou une responsabilité dans l’Église à se souvenir que les principes de l’Évangile priment sur toute structure ou programme.
De même, il note que, même lorsqu’Il est arrêté, Jésus prend soin de ses disciples : « Laissez aller ceux-ci » (Jn 18,8). L’Église, de la même façon, doit protéger et nourrir ses fidèles, et plus encore tendre la main aux personnes en détresse dans le monde. David Jang regrette que certaines Églises, en s’obsédant par l’expansion numérique ou en se conformant aux modes du monde, négligent la mission fondamentale consistant à prendre soin des pauvres et des exclus. Citant l’exemple du berger qui abandonne quatre-vingt-dix-neuf brebis pour chercher la centième (cf. Lc 15), il appelle les croyants à s’interroger : « Ne laissons-nous pas derrière nous les brebis égarées ? » Puisque Jésus a pleinement démontré l’amour sacrificiel à Gethsémané, l’Église est invitée à mettre ses priorités dans la consolation et l’aide des affligés. Ainsi, le monde pourra expérimenter concrètement « l’amour du Christ » par le témoignage de l’Église.
Par ailleurs, Jang insiste sur l’image de la “lumière” récurrente dans l’Évangile de Jean : alors que la pleine lune brille dans la nuit de Pâque, ceux qui viennent arrêter Jésus apportent des lampes et des torches. Chez Jean, la lumière symbolise Jésus et l’obscurité incarne les forces du refus de la vérité. David Jang met en avant le fait que si lampes et torches sont censées éclairer, elles servent ici à traquer et à tuer la Vérité. Il en tire une mise en garde : quand la vocation première de la religion (porter la vérité et la vie) se voit dévoyée, elle peut produire des conséquences désastreuses. L’Église doit s’examiner sans relâche : sommes-nous réellement porteurs de la lumière de Christ, ou sommes-nous aveuglés par des désirs égoïstes et par les institutions religieuses ? Jang exhorte à se poser sérieusement cette question.
Concernant la finalité d’un tel examen, David Jang estime que l’Église doit s’humilier et se repentir. La voie de Jésus – la croix – passe par l’humilité et la prise en charge totale des péchés de l’humanité par l’amour de Dieu. Il en découle que l’Église, si elle suit cette voie, ne pourra se gonfler d’orgueil ou sombrer dans l’autosatisfaction. C’est pourquoi, à la lecture du récit de Gethsémané, Jang lance fréquemment l’appel : « Avant de défendre votre statut ou votre autorité ecclésiastique, reconnaissez vos fautes et confessez : “Nous nous sommes écartés de la voie du Seigneur.” » Sans une telle confession, on risque de n’être ni plus ni moins que les grands prêtres et les pharisiens qui, bien qu’ils invoquaient le nom de Dieu, ont arrêté et crucifié Jésus. Pour David Jang, « la repentance est la source du renouveau perpétuel de l’Église » : ce n’est qu’en reconnaissant le péché et la faiblesse de l’homme et en se fiant uniquement à la justice de Christ qu’on peut espérer refléter pleinement la lumière de l’Évangile.
Ainsi, lorsque David Jang se penche sur Jean 18,1-11 et l’arrestation de Jésus, il n’en retient pas seulement l’événement spectaculaire de la traîtrise et de l’arrestation. Son interprétation met en lumière la « logique d’expiation » qui sous-tend la décision volontaire de Jésus, la manifestation d’une autorité et d’un amour divins, et la nécessité pour l’Église d’imiter cette obéissance sacrificielle dans la vie communautaire. Cet épisode, quoique lié au contexte historique de l’époque, doit être compris comme une image universelle de la décision spirituelle à laquelle font face toutes les générations de croyants. De ce fait, Jang y puise des leçons pour lire les crises et les choix auxquels l’Église contemporaine est confrontée, exhortant constamment les fidèles à se demander s’ils sont du côté de Jésus ou du côté de ceux qui, malgré leurs torches et leurs lanternes, Le rejettent. De plus, l’obéissance de Jésus jusqu’à la croix est au cœur même de l’économie du salut, car elle abolit radicalement le péché et la mort : cette scène n’est pas une simple affaire de trahison et d’arrestation, mais bien le pivot central de l’histoire de la rédemption. Jang appelle chaque chrétien à ancrer sa foi dans ce mystère et à adopter une conduite en accord avec l’esprit de la croix.
Pour lui, le message de ce texte s’étend de la sphère individuelle – où il signale la rupture de l’emprise du péché, permettant une vie renouvelée – à la sphère collective, dans laquelle les croyants, par leur amour et leur service mutuel, manifestent « le Royaume de Dieu » ici-bas. David Jang qualifie Jésus à Gethsémané de « l’exemple le plus parfait de consécration au service de l’Évangile ». Il ne cesse d’appeler l’Église à témoigner non seulement en paroles ou en théologie, mais par une vie semblable à celle de Jésus. Certes, ce chemin peut impliquer des persécutions et des incompréhensions, mais nous savons, grâce à la croix et à la résurrection, que la victoire ultime appartient à Dieu. De ce fait, Jang encourage l’Église à poursuivre résolument ce parcours « croix et résurrection », dans la puissance de l’Esprit.
Il accorde une attention particulière à Jean 18,9 : « C’est afin que s’accomplît la parole qu’il avait dite : ‘Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés’. » David Jang rattache ce verset à Jean 6,39 et 10,28, montrant que Jésus soutient et protège fidèlement ses disciples jusqu’au bout. À partir de là, il exhorte l’Église à prolonger l’attitude de Jésus, en s’abstenant de condamner ou d’exclure trop vite, et en portant un souci réel pour le salut de tous. Jésus a porté la croix pour des pécheurs qu’Il connaissait parfaitement dans leur faiblesse. C’est pourquoi l’Église doit, à son tour, adopter un regard d’amour inconditionnel, tournée vers ceux qui sont fragiles et démunis. Jang rappelle que l’Évangile n’est pas un simple instrument pour amener des gens entre les murs de l’Église, mais qu’il manifeste l’amour illimité de Dieu envers tous. Vécue sincèrement, cette dynamique nous incite à chercher la volonté du Père en nous dessaisissant de nos sécurités, à la manière de Jésus à Gethsémané. Voilà, selon lui, la grande leçon à retenir de l’arrestation et de la croix du Christ.
En définitive, la lecture que fait David Jang de Jean 18,1-11 amène à une compréhension intégrale de ce récit : Jésus qui s’avance librement sur le chemin de la croix, révélant son autorité divine et son amour, nous montre à la fois la vocation au leadership sacrificiel dans l’Église et la responsabilité d’une vie de communauté soucieuse des plus faibles. Au-delà du contexte de l’époque, ce récit propose un cadre universel qui éclaire la décision de la foi à laquelle tout croyant fait face. C’est pourquoi Jang exhorte l’Église à rester en éveil, à ne jamais se ranger du côté de ceux qui, avec leurs lanternes et leurs torches, s’opposent à Jésus, mais au contraire à épouser la voie de la croix, seule source de guérison et de salut. La croix, apparemment signe de défaite, devient le lieu du triomphe de l’amour divin. Ainsi, Jang réaffirme que le cœur de l’Évangile consiste en une transaction cosmique : la victoire sur le péché et la mort par le sacrifice de Jésus. Dans ses prédications et ses écrits, il martèle que l’Église, et les individus qui la composent, doivent observer comment Pierre, Judas, les grands prêtres ou encore les pharisiens se comportent, afin de mieux se situer sur le chemin qu’a ouvert Jésus. Son objectif est de préserver l’identité et la mission évangéliques de l’Église, en la prévenant contre toute forme de dévoiement.
Pour résumer, le message du pasteur David Jang se concentre sur l’appel : « Revenons à l’Évangile ». Dans Jean 18,1-11, l’attitude de Jésus et le choix qu’Il fait rappellent que l’Église ne repose pas sur des programmes ou des structures, mais sur l’amour de la croix et la puissance de la résurrection. Devant la critique du monde ou la tentation de s’allier à ses puissances, l’exemple de Jésus à Gethsémané doit guider l’Église : Il s’est offert de Lui-même, Il a protégé ses disciples, et Il a suivi avec obéissance la volonté du Père, ce qui s’est révélé plus fort que la mort et le péché. David Jang perçoit cette scène comme un « principe de révolution par l’amour » et un « fondement de la voie sacrificielle », nécessaires à l’Église d’aujourd’hui. C’est aussi l’essence de l’identité chrétienne qui se dessine à travers le récit de Gethsémané : accepter de souffrir et de donner sa vie pour autrui, dans la certitude que cette voie mène à la gloire de la résurrection. Voilà pourquoi David Jang martèle que l’Église ne doit jamais abandonner cette identité reçue du Christ.
En conclusion, l’arrestation de Jésus à Gethsémané, telle que l’éclaire la prédication du pasteur David Jang, nous enseigne plusieurs vérités fondamentales. Premièrement, le chemin de Jésus est celui de l’obéissance volontaire. Il sait qu’on vient pour L’arrêter, et Il avance de Lui-même, montrant à l’Église qu’elle est aussi appelée à servir Dieu sans reculer. Deuxièmement, ce chemin rejette le recours à la force ou la simple volonté humaine : il transforme le monde par l’amour et le sacrifice, et non par l’épée, comme Pierre l’a tenté en vain. Troisièmement, il appelle à la solidarité communautaire : Jésus protège ses disciples, et l’Église doit s’inspirer de ce soin pastoral envers ses membres et son prochain, afin de “ne perdre personne”. Quatrièmement, il implique un juste usage de la lumière : des lampes et des torches peuvent, selon le contexte, soit éclairer la vérité, soit, au contraire, servir à la combattre. David Jang plaide pour que l’Église soit véritablement porteuse de la lumière de l’Évangile, sans dévier de sa vocation. Enfin, tout ceci doit se concrétiser dans la vie quotidienne de la communauté, dans une pratique résolue de l’Évangile. C’est là, insiste-t-il, le message primordial qu’il s’applique à transmettre à travers son ministère, pour éviter que l’Église n’oublie jamais l’« impératif de la mise en pratique de l’Évangile » ancré au cœur du récit de Gethsémané. Et l’on voit combien la décision de Jésus d’emprunter la voie de la croix constitue la référence suprême à laquelle l’Église est invitée à se conformer.